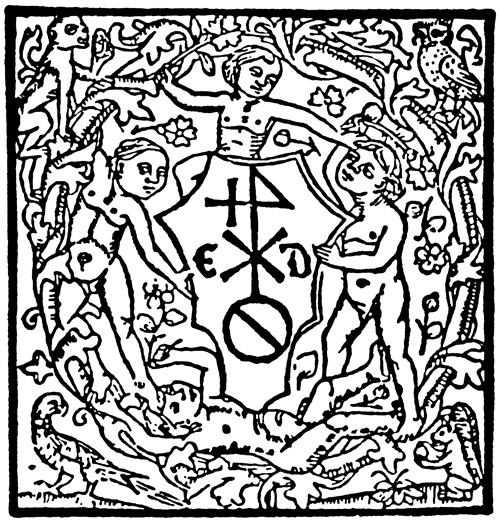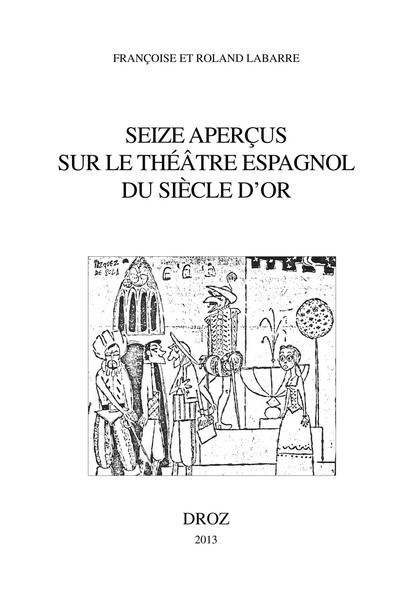XVIIe siècle
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
La réception en France du théâtre de Cervantès
La réception en France de la comedia
A propos de la date de Peribáñez y el Comendador de Ocaña
Le duc de Viseu, drame du despotisme
L’énigme de Fuente Ovejuna
La tragédie pathétique du Chevalier d’Olmedo
Défense et illustration de l’Espagne chez Lope de Vega
« D’une mère d’illustre origine et d’un père de sang généreux »
A propos de la date de El vergonzoso en palacio
Le Timide à la Cour : histoire, politique et littérature
Le Timide à la Cour : fantaisie et jeu
Les brunes aux yeux noirs
Deux bons serviteurs de Calderón
Le plus grand monstre qui soit au monde
Variations espagnoles sur le thème des amants de Vérone
Horreur et compassion
Index des pièces espagnoles citées avec, entre parenthèses, leurs adaptations françaises
Index des auteurs, traducteurs, adaptateurs, metteurs en scène, décorateurs, principaux acteurs, critiques dramatiques, essayistes et historiens du théâtre
Ce recueil de travaux est le fruit de longues recherches et d’une enquête persévérante auprès des traducteurs, metteurs en scène, comédiens ou décorateurs qui contribuèrent à faire revivre sur les planches, au siècle dernier, un genre littéraire qui eut son heure de gloire sous les règnes de Philippe II, Philippe III et Philippe IV d’Espagne. Toujours avec le même refus du convenu, il dresse un historique largement inédit de la réception en France de ces comédies et tragi-comédies qui inspirèrent à Corneille, Rotrou, Molière et Marivaux des œuvres aussi applaudies que Le Cid, Le Menteur, Le Véritable saint Genest, Dom Juan, La Surprise de l’amour et Les Fausses confidences. Il découvre les racines secrètes de drames toujours admirés comme Peribáñez, Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo ou la plaisante comédie El vergonzoso en Palacio. Il déterre une tragédie politique aussi puissante qu’El duque de Viseo. Il illustre, par des exemples tirés de vingt-deux comédies ou tragi-comédies, la fidélité avec laquelle Lope de Vega s’est plu à refléter les sentiments des Espagnols de son temps. Il révèle les origines familiales de Tirso de Molina et il propose une lecture de El médico de su honra dégagée de toute concession au « prêt-à-penser » identitaire. Il rend un hommage mérité à tous ceux qui, à l’exemple de Charles Dullin, Jean-Louis Barrault, Daniel Leveugle ou Jean Vilar, osèrent rompre avec les facilités du théâtre de boulevard pour faire applaudir, à travers toute la France, quelques-uns des plus beaux drames du théâtre espagnol du Siècle d’or.
CONTRIBUTEURS
BARDIN Pierre, Association Généalogie et Histoire de la Caraïbe.
BERNARDIN Florian, étudiant à l’Université de Nantes (dir. É. Noël).
CHÉTANNEAU Sébastien, étudiant à l’Université de Nantes (dir. É. Noël).
FAGOUR Yvelle, étudiante à l’Université des Antilles-Guyane (dir. É. Noël).
GRANGER Sylvie, maître de conférences à l’Université du Maine.
HAUDRÈRE Philippe, professeur à l’Université d’Angers.
MICHON Bernard, maître de conférences à l’Université de Nantes.
MITCHELL Robin, professeur assistante à Depaul University, Chicago.
NOËL Erick, professeur à l’Université des Antilles-Guyane.
PEABODY Sue, professeur à Washington State University.
RAFFIN Thomas, étudiant à l’Université de Nantes (dir. É. Noël).
ROGERS Dominique, maître de conférences à l’Université des Antilles-Guyane.
SAUPIN Guy, professeur à l’Université de Nantes.
Le Dictionnaire des gens de couleur, après un volume consacré à Paris et à son bassin, approche ici tous ceux qui, passés en Bretagne, ont constitué la part la plus importante au terme d’un circuit triangulaire dominé par Nantes. Sur plus de 15 000 hommes et femmes amenés en France entre les grandes découvertes et la révolution, au moins la moitié ont en effet été retenus par la province la plus engagée dans le trafic négrier.
Cette situation est singulière : en plein siècle des Lumières, la capitale de la traite a réussi à faire avaliser un droit à l’esclavage dans un royaume où la liberté avait été érigée en principe fondamental. Méticuleusement analysés, les fonds des archives locales, aussi bien que départementales et nationales, à travers l’armement maritime, les registres des amirautés et jusqu’à ceux des paroisses, ont révélé l’existence de ces « nègres esclaves », rarement affranchis, dans l’ombre des moindres familles bourgeoises.
Ainsi découvrira-t-on, loin de l’Afrique et des Îles où ils avaient grandi, des cohortes de gens de maison et de métier, en théorie appelés à retourner sur les plantations d’où ils venaient. La réalité révèle surtout un monde de petites gens, capables de s’entraider dans des ports où ils pouvaient craindre un renvoi aux colonies et, dans le meilleur des cas, accéder à une liberté garantie par l’exercice d’une activité, parfois spécialisée, au sein de quartiers où leurs figures ont inspiré ces mascarons figés en façade des hôtels des négriers.
Pierre et Marie-Hélène Servet rassemblent, pour la première fois dans une édition critique, plus de 90 testaments, fictifs dans leur immense majorité, écrits dans la lignée de l’œuvre de Villon entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe siècle. Ces textes, inédits pour certains, souvent difficilement accessibles, sont accompagnés d’un apparat critique qui leur apporte la contextualisation et les éclairages historique, littéraire, linguistique, éditorial, indispensables. L’introduction générale propose une réflexion approfondie sur les sources juridiques – le testament civil – et littéraires, l’orientation facétieuse et/ou polémique de ces textes, la diversité de leurs registres, de la satire au pamphlet, et de leurs idéologies, leurs regroupements et leur évolution au fil des foyers pamphlétaires (guerres de religion, Mazarinades, phases de la Révolution). Cette édition permet ainsi de mettre au jour l’existence d’un nouveau genre littéraire, saisi dans son évolution, son apogée, son déclin ; elle propose aussi une réflexion plus générale sur la littérature de combat et sur le fonctionnement de la vie littéraire à travers les jeux de réécriture et de rééditions ; elle ouvre enfin des perspectives sur la subversion des formes et des genres par l’écriture polémique.
Au cours du XVIIe siècle, dans les couvents de toute la catholicité, furent écrites des milliers de vies de religieuses : ordres anciens réformés (comme les carmélites, les bénédictines, les cisterciennes) et ordres nouveaux (comme les visitandines, ou les ursulines) furent ainsi le lieu d’une extraordinaire production de textes où, dès leur mort, était retracée la vie des religieuses, où étaient exposés leurs vertus, leurs souffrances, leurs maladies, leurs rêves, leurs mortifications, leurs extases et leurs jouissances célestes. Cette riche source de documents permet de pénétrer dans l’intimité de ces femmes, au delà des formes ritualisées de leur existence et des censures qu’imposaient les documents officiels. Le présent ouvrage, portant sur les biographies de religieuses essentiellement françaises constitue ainsi une page importante de l’histoire des représentations et des pratiques spirituelles, corporelles et sociales dans les couvents féminins du XVIIe siècle.
Table des matières / I. GARNIER et O. LEPATRE, « Introduction » – THEORIE – M.-H. SERVET, « Impertinent, Impertinence : les mots et la chose » ; M. LEVESQUE, « "Je m’en sers de ma seule autorité" : possibilité et enjeux d’un usage impertinent de la langue au XVIIe siècle » ; F. BOISSIERAS, « Approche rhétorique et pragmatique de la notion d’impertinence » – L’IMPERTINENCE GENERIQUE – A.-P. POUEY-MOUNOU, « Impertinences montaigniennes : la "suffisance" des Essais » ; M.-C. THOMINE-BICHARD « Les impertinences d’Eutrapel : Baliverneries (1548) et Contes et Discours d’Eutrapel (1585) » ; P. MOUNIER, « Le roman et l’humanisme : anticonformisme d’un genre à la Renaissance » ; A. ROOSE, « L’impropre et l’obscène dans Alector de Barthélémy Aneau » ; Y. CHARARA, « Les Aventures de Télémaque de Fénelon inspiration mystique et scandale générique » – LES GENRES DE L’IMPERTINENCE – M. AUBAGUE, « Les Trois Francion de Charles Sorel (1623, 1626, 1633) : impertinence générique et voix d’auteur » ; F. POULET, « De la satire des ridicules à la parrêsia : impertinence et extravagance dans l’histoire comique (1620-1660) » ; D. BERTRAND, « Impertinentes traversées urbaines : risque de la parrêsia et frontières de l’acceptabilité burlesque » ; H. DURANTON, « Au-delà de l’impertinence : la littérature satirique versifiée (1715-1789) » ; P. CAMBOU, « L’obscène et le saugrenu comme formes d’impertinence dans le conte voltairien » ; C. RAMON, « La transgression des libertins : une affaire de genre ? (Crébillon, Sade, Nerciat) » ; M. TSIMBIDY, « De l’impertinence des Mémoires ou des mémorialistes sous Louis XIV » ; K. ABIVEN, « Les impertinences de l’Histoire : une question d’aptum générique » ; F. WILD, « Savoir et impertinence dans les ana » ; P. GETHNER, « Le Proverbe dramatique, genre de l’impertinence » – Impertinence et bienséances – T. TRAN, « Les impertinences de la parole : collusions génériques et renversement satirique dans les Loups ravissans de Robert Gobin (c. 1505) » ; O. LEPLATRE, « L’impertinence des images : mont(r)er. A propos de l’Enigme joyeuse pour les bons esprits et du Centre de l’amour » ; P. EICHEL-LOJKINE, « Le conte merveilleux, un genre autorisant l’impertinence ? Bienséance, contrôle, image dans "Le Maître Chat ou le Chat Botté" » ; M.-M. FRAGONARD, « Livres de piété, prédication et modes féminines : l’enfer des bonnes intentions » ; C. ARONICA, « Quand les désirs sont désordre. Le corps impertinent de la tragédie classique » ; C. BARBAFIERI, « "La femme est le potage de l’homme" : les plaisanteries malséantes dans la France classique » ; M. BERMANN, « Les Contes et Nouvelles en vers ou une mondanité impertinente » ; C. LIGNEREUX, « Le conseil, un acte de langage contraire aux bienséances ? » – IMPERTINENCE, AUTORITE ET AUCTORIALITE – D. Reguig, « Impertinence et littérarité chez Boileau » ; C. BAHIER-PORTE, « Les réécritures "modernes" du bouclier d’Achille : l’inavouable pertinence d’un modèle inconvenant (Lesage, La Motte, Marivaux) » ; C. HAMMANN, « Pertinence du dé-plaire : une mise en cause de l’aptum dans les Lettres au XVIIIe siècle ».
L’impertinence a longtemps eu mauvaise presse. Sottise ou fatuité, extravagance ou importunité, l’impertinence choque, indispose, heurte l’usage ou la bienséance. Quand elle s’invite en littérature, elle fournit bien plus que l’étoffe de personnages de comédie – médecins ou coquettes – ou de romans burlesques : elle joue avec les codes sociaux et les normes de la représentation, bousculant les frontières des genres établis qu’elle subvertit ou régénère.
Après une mise en perspective conceptuelle de la notion, vingt-neuf études éclairent ici les multiples facettes de l’impertinence sous l’Ancien Régime. Elles les envisagent en diachronie d’un point de vue lexical, rhétorique, générique, en jouant de la complémentarité des approches. Composant un savoureux pot-pourri, roman, conte, histoire fabuleuse, énigme, recueil d’emblèmes, livres de piété, tragédie, mémoires, chansons satiriques, images tendancieuses, apparaissent tantôt comme lieux de l’impertinence générique, tantôt comme genres de l’impertinence.
Énergie créatrice au XVIe siècle, sulfureux débordement à canaliser au siècle classique, elle devient force émancipatrice pour les Lumières. En à peine plus d’un siècle, l’impertinence inverse totalement sa valeur socio-esthétique et contribue à faire jaillir la vérité en se soustrayant au carcan des codes. Stigmatisée comme vice par l’opinion commune, retournement de la folie en sagesse pour les écrivains indociles – qu’on peut considérer précurseurs –, elle apparaît comme qualité de l’intelligence et de l’esprit – pour ne pas dire vertu – et finit par imprégner toute une époque, valeur partagée d’un temps qui, par sa liberté de penser et d’écrire, marque encore le nôtre.
AVANT-PROPOS, Max Engammare
INTRODUCTION
1. Pourquoi étudier les hébraïsants chrétiens en France ?
2. Définition du corpus et choix des dates
3. Place particulière de l’hébreu dans la réflexion grammaticale au 16e siècle
4. Objectifs de ce travail
CHAPITRE 1 : L’ENSEIGNEMENT DE L’HÉBREU EN FRANCE
SECTION 1 : Pourquoi étudie-t-on l’hébreu ?
1.1. Hébreu et théologie
1.1.1. L’hébreu langue sainte
1.1.2. Persistance du motif apologétique
1.1.3. Le paradoxe du recours aux sources juives
1.1.4. Une méfiance réciproque
1.2. L’étude de l’hébreu comme nécessité scientifique et intellectuelle
1.2.1. L’hébreu est absolument nécessaire à la compréhension de l’Ecriture
1.2.2. L'hébreu, langue parfaite
1.2.3. L’hébreu, langue primitive et universelle
1.2.4. Plaisir de l’hébreu
1.2.5. L’hébreu et les autres langues orientales
1.3. Conclusion
SECTION 2 : L’enseignement de l’hébreu en France à l’époque médiévale
SECTION 3 : Enseignants et étudiants d’hébreu (1500-1680)
3.1. Introduction
3.1.1. Nouvelles élites, nouveaux savoirs
3.1.2. « Par toutes les provinces de la Gaule »
3.2. Le rôle des juifs convertis
3.3. Les lecteurs royaux et leurs élèves
3.3.1. Les chaires d’hébreu de 1530 à 1670
3.3.3. Etudiants
3.3.4. Programmes et méthodes
3.3.4.1. Le premier document
3.3.4.2. Les autres témoignages
3.3.5. Conclusion
3.4. Catholiques et protestants
3.4.1. Les études hébraïques en milieu protestant
3.4.1.1. Dans l’enseignement secondaire
3.4.1.2. Dans les académies
3.4.2. Place de l’hébreu dans l’enseignement des jésuites
3.5. Leçons privées, autodidactes
CHAPITRE 2 : IMPRESSION ET DIFFUSION DES GRAMMAIRES HÉBRAÏQUES
SECTION 1 : L’imprimerie hébraïque en France
1.1. Lieux d’impression
1.2. Imprimeurs et typographes
1.2.1. Qui sont-ils ?
1.2.2. Premières impressions
1.2.3. La typographie royale
1.2.4. Ateliers juifs et ateliers chrétiens
1.2.5. Caractères
SECTION 2 : La publication des grammaires, de 1509 à 1670
2.1. Tableau des publications en Europe
2.2. Commentaires
SECTION 3 : L’alphabetum hebraicum, une spécialité française du 16e siècle
3.1. Généralités
3.2. La publication des alphabets
3.3. Le problème des alphabets de c. 1512 et c. 1514
SECTION 4 : Les inventaires de bibliothèques nous renseignent-ils sur la diffusion des connaissances hebraïques ?
4.1. Introduction
4.2. Quels outils de travail trouve-t-on dans les inventaires ?
4.3. Apprenait-on vraiment l’hébreu ?
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 3 : L’ALPHABETUM HEBRAICUM, CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTION
SECTION 1 : Avant 1520
SECTION 2 : Les alphabets d’Estienne
2.1. L’alphabetum graecum et hebraicum de 1528
2.2. L’alphabetum hebraicum de 1539
2.2.1. Présentation générale de l’ouvrage
2.2.2. Consonnes et voyelles
2.2.3. Règles diverses de prononciation
2.2.4. Les exercices
2.2.5. Conclusions sur l’alphabet de 1539
2.3. Editions ultérieures de l’alphabetum hebraicum
2.4. Les éditions de 1563 et 1566 (Paris)
2.5. L’édition d’A. R. Chevalier
2.6. Remarques finales
SECTION 3 : Autres alphabets
3.1. Les alphabets de Guidacerius
3.2. L’alphabet de Drosay (1543)
3.3. Les alphabets de G. Génébrard
3.4. Les ouvrages de J. Boulaese
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 4 : FRANÇOIS TISSARD
SECTION 1 : Données biographiques
SECTION 2 : Les ouvrages publiés par F. Tissard
SECTION 3 : Pourquoi l’hébreu ?
3.1. Les motivations de Tissard
3.2. Tissard et les juifs
SECTION 4 : La première grammaire de l’hébreu publiée en France
4.1. Plan de l’ouvrage de 1509
4.2. L’alphabetum hebraicum (fol. 24r°)
4.3. Eléments de phonétique
4.4. Exercices de lecture
4.5. Le nom
4.6. Morphologie verbale
4.7. La terminologie de Tissard
4.8. Quelle grammaire Tissard a-t-il utilisée ?
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 5 : SANCTES PAGNINUS, TRADUCTEUR ET GRAMMAIRIEN
SECTION 1 : Données biographiques
SECTION 2 : Pagninus traducteur de la bible
2.1. Relation à saint Jérôme
2.2. Quelques exemples de la méthode de Pagninus
2.3. Postérité de la nova translatio
SECTION 3 : Les Hebraicarum institutionum libri quatuor
3.1. L’édition de 1526
3.2. L’édition de 1549
3.3. Les éditions abrégées
SECTION 4 : PAGNINUS GRAMMAIRIEN
4.1. Plan de la grammaire
4.2. Théorie de la langue hébraïque
4.3. Phonétique
4.3.1. Les voyelles . 131
4.3.2. Le šewā
4.3.3. Les consonnes
4.3.4. Conclusion
4.4. Le nom
4.4.1. Le recours aux cas
4.4.2. Les catégories du nom
4.4.3. L’état construit
4.4.4. Morphologie du nom
4.4.5. Le pronom
4.5. Traitement du verbe
4.5.1. Le nipal
4.5.2. Le paradigme
4.6. La description morphologique chez Pagninus : conclusion
4.7. Le livre IV
4.8. Syntaxe
4.7. La question des sources
4.7.1. Auteurs juifs médiévaux
4.7.2. Pagninus et Reuchlin
4.7.3. Pagninus et Münster
SECTION 5 : LE THESAURUS LINGUAE SANCTAE
5.1. L’édition de 1529
5.2. L’édition de 1548
5.3. Les éditions annotées par Mercier
5.4. Les éditions abrégées
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 6 : L’« ÉCOLE DE LOUVAIN », CLÉNARD ET CAMPENSIS
SECTION 1 : Clénard et les langues orientales
SECTION 2 : La Tabula in grammaticen hebraeam de Clénard
2.1. L’édition de 1529
2.2. L’édition de 1544 (Wechel)
2.2.1. Plan de la grammaire
2.2.2. Description phonétique
2.2.3. Les paradigmes verbaux
2.2.4. Le nom
2.2.5. Terminologie
2.3. L’édition revue par Cinqarbres (1550)
2.4. La réédition de 1564
SECTION 3 : La pédagogie clénardienne
SECTION 4 : Les relations Campensis / Clénard
4.1. La grammaire de Campensis
4.2. De la grammaire de Campensis à la Tabula de Clénard
4.3. « Campensem nollem videri emendare »
4.3.1. Rivalités
4.3.2. La personnalité de Clénard d’après sa correspondance
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 7 : AUTOUR DES LECTEURS ROYAUX (1530-1587)
SECTION 1 : Les rudimenta de cheradame
1.1. Chéradame est-il l’auteur des Rudimenta ?
1.2. Des « rudiments » bien nommés
SECTION 2 : Agathius Guidacerius
2.1. Les préfaces de Guidacerius
2.2. Sa méthode
SECTION 3 : Le Dialogus de Paul Paradis
SECTION 4 : Vatable et le sens littéral
4.1.
4.2. Les notes de Vatable
4.2.1. Hébraïsmes
4.2.2. La philologie au secours de l’exégèse
4.2.3. Les temps verbaux
SECTION 5 : Un disciple de Guidacerius, Alain Restauld de Caligny
SECTION 6 : R. Baynes, continuateur de Pagninus
SECTION 7 : Jean Mercier et les commencements de l’étude du Targum 186
7.1. Le goût de l’exégèse littérale
7.2. Les tabulae in chaldaeam grammaticen (1550)
SECTION 8 : Un continuateur de Clénard Jean Cinqarbres
8.1. L’édition de 1546
8.2. L’Epitome operis de re grammatica de 1559
8.3. L’édition de 1609
SECTION 9 : L’émergence de la litteérature rabbinique : Génébrard
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 8 : LA GRAMMAIRE HÉBRAÏQUE EN FRANCE DE 1500 A 1570, ESSAI DE SYNTHÈSE
SECTION 1 : La description phonétique
SECTION 2 : Questions de morphologie
SECTION 3 : « Les Hébreux n’ont pas de cas, mais… »
SECTION 4 : Apparition d’une terminologie spécifique
4.1. L’utilisation de termes traditionnels
4.2. La mise en relation des deux systèmes
4.3. L’utilisation métalinguistique de termes latins de la langue courante
4.4. Le recours à des néologismes
4.5. Deux cas particuliers : « affixe » et « radix »
4.5.1. Affixe
4.5.2. « Radix »
SECTION 5 : La question des sources
5.1. Le « priscien hébreu » : David Qimhi
5.2. « Transfert de connaissances » du monde juif au monde chrétien
5.3. L’influence de Lévita
5.4. Conclusion
SECTION 6 : Les « langues orientales » et les premières tentatives de grammaire comparée
6.1. L’arabe dans les grammaires hébraïques
6.2. Deux précurseurs de la philologie comparée : Postel et Caninius
CONCLUSION DU CHAPITRE
CHAPITRE 9 : LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
SECTION 1 : Les grammaires publiées en france de 1600 à 1649
1.1. La grammaire de Bellarmin annotée par De Muis (1622)
1.2. La grammaire de G. Mayr (1622)
1.3. La grammaire de Thomas Dufour (1642)
1.4. La grammaire de Nicolas Abram (1645)
1.5. Conclusion
SECTION 2 : Hébreu rabbinique et lexicographie
1.1. Philippe d’Aquin (c. 1575-1650)
1.2. Jean Plantavit de la Pause (1576-1651)
SECTION 3 : P. RAMUS, P. MARTIN, ET J. BUXTORF
3.1. La grammaire de P. Martinius
3.2. Comparaison Buxtorf/Martinius : plan de la grammaire
3.2. Comparaison Buxtorf/Martinius : définitions
3.3. Postérité de la grammaire de Martinius
CONCLUSION DU CHAPITRE
CONCLUSION GÉNÉRALE
Un rôle de diffusion à réestimer
Du bon usage des manuels scolaires
Les lecteurs royaux
Importance de Pagninus
La désacralisation de l’hébreu
De la grammaire à la critique
ANNEXES
Annexe n° 1 : Le décret « inter sollicitudines » sur l’enseignement des langues orientales
Annexe n° 2 : Reproduction du « placard » de 1534
Annexe n° 3 : La publication des grammaires en France (1509-1650)
Annexe n° 4 : La publication des alphabets en France
Annexe n° 5 : Description des exemplaires étudiés
Annexe n° 6 : Les termes du métalangage de F. Tissard
BIBLIOGRAPHIE
INDEX NOMINUM
Sophie Kessler-Mesguich nous a quittés trop tôt, beaucoup trop tôt (8 février 2010), sans avoir eu le temps de donner la mesure de tout ce qu’elle connaissait de la grammaire historique de l’hébreu, sans avoir pu achever cette grammaire de l’hébreu moderne qui était devenue son dessein majeur. Elle n’avait jamais publié sa thèse de doctorat, soutenue le 19 décembre 1994 à l’Université de Paris VIII, voulant constamment la parfaire. Cette thèse, Les études hébraïques en France, de François Tissard à Richard Simon (1510- 1685), n'a pourtant pas pris une ride et il était indispensable de la publier. Une double compétence est exigible pour quiconque souhaite étudier les grammaires de l’hébreu en France au seizième siècle : une maîtrise de l’hébreu (et de l’araméen) et une familiarité érudite du latin linguistique de la Renaissance. Sophie Kessler-Mesguich avait acquis ces deux compétences. Personne avant elle n’avait si bien présenté et analysé l’œuvre de François Tissard, la publication de son Alphabetum Hebraicum et de sa Grammatica Hebraica, ayant identifié toutes les sources de Tissard. Qui est capable de reprendre un tel travail et de nous montrer que c’est en helléniste que Tissard a approché la langue hébraïque et utilisé la grammaire de Qimhi? On peut formuler une question identique avec Sante Pagnini et ses Hebraicarum institutionum libri quatuor de 1526. Sophie Kessler-Mesguich a ainsi établi que le premier livre des Institutiones Hebraicæ est “remarquable par sa précision, tant dans la description phonétique que dans les transcriptions”. Quant au deuxième livre, consacré au nom et au pronom, l'auteur montre que Pagnini s’appuie à la fois sur le Mikhlol de David Qimhi et sur le Ma‘aseh ’Efod. Tout au long de ce livre, le spécialiste comme le débutant sont éclairés et nourris, très souvent conquis.
Ce deuxième tome des œuvres de Scévole de Sainte-Marthe contient ce qui fut imprimé entre les Premieres Œuvres de 1569 et les publications de 1575 (à paraître dans un troisième volume).
L’actualité des années 1569- 1573 est très présente dans le volume : troisième guerre civile, mariages de Charles IX avec Élisabeth d’Autriche puis de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, quatrième guerre et siège de La Rochelle. D’autre part Sainte-Marthe, pourvu de l’office de Contrôleur général des Finances en Poitou, adresse des vers à ses nouvelles relations, particulièrement les « gens des finances », qui se trouvent ainsi associés à ses connaissances parisiennes. L’annotation s’efforce d’apporter des informations sur les dédicataires du poète et les auteurs de pièces liminaires, complétant notre connaissance de la société poitevine et de la vie littéraire en France dans la seconde moitié du XVIe siècle.
Plus généralement, le livre s’inscrit dans une perspective clairement iréniste : dans le dernier sonnet, l’auteur attribue à sa poésie la capacité de « tempérer le Discord » et se juge par là investi du pouvoir de faire revenir la paix ; cette signification essentielle du recueil peut être étendue à l’ensemble du contenu du tome II.
L’édition des Œuvres complètes de Scévole de Sainte-Marthe est établie par Jean Brunel, Professeur honoraire à la Faculté des Lettres de Poitiers, avec la collaboration de Pierre Martin, professeur dans la même Université.
Peut-on être Français et parler une autre langue que le français ? Au XVIe siècle, la réponse est évidente : la vitalité, à l’oral, des langues de France (occitan, basque, breton, dialectes d’oïl, francoprovençal) fait partie de l’expérience quotidienne. C’est pourtant bien à ce moment-là que s’établit, dans l’espace culturel français, la hiérarchie qui prévaut encore de nos jours entre le français, langue haute comme le latin, et les langues locales, réputées basses. Cette répartition intervient moins sous l’effet de la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) qui impose de rédiger en français « et non autrement » tous les actes administratifs que selon des critères sociaux. Dès le milieu du siècle précédent, les élites abandonnent peu à peu leur langue locale et épousent la cause d’une langue qui est à la fois celle du roi, du droit et de la culture dominante. La réflexion qui s’engage au XVIe siècle autour de la norme du français est menée par les théoriciens de la langue (grammairiens, auteurs d’arts poétiques) et elle se trouve relayée par des praticiens de la littérature (Rabelais et ses épigones). Globalement, la tendance qui s’impose est celle de la dévalorisation des parlers de France et du refus de la variation.
Cette marginalisation de la différence linguistique se heurte à la réalité de terrain pour l’Église de la Contre-Réforme qui développe des stratégies différentes selon les régions, engagée au Pays basque, mitigée, voire hostile, ailleurs. Finalement, ce sont les poètes qui choisissent d’écrire dans ces langues, comme l’occitan, qui en assurent la défense la plus efficace, posant cependant la question de l’autonomie de cette production littéraire par rapport aux schémas dominants français.